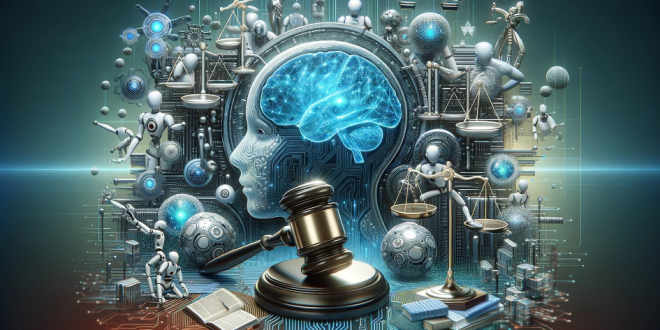Par Ahmed Khaouja (*)
Introduction
À la frontière entre science du cerveau et technologies numériques, un bouleversement silencieux est en marche. L’interaction entre les neurosciences et l’intelligence artificielle (IA) engendre une nouvelle génération de dispositifs : les neurotechnologies. Capables d’observer, d’interpréter, voire d’interagir avec l’activité cérébrale, ces outils repoussent les limites de notre compréhension… mais aussi celles de l’éthique.
Face à l’explosion des données cérébrales, issues de l’IRM, de l’EEG, de l’EMG ou des interfaces cerveau-machine, l’IA s’impose comme un levier indispensable : elle analyse des flux complexes, détecte des modèles invisibles à l’œil humain et ouvre des perspectives sans précédent dans la santé, l’éducation, le travail ou la défense.
Mais cette puissance soulève une question centrale : jusqu’où peut-on explorer l’esprit humain sans compromettre sa liberté ?
-
Neurotechnologies et IA : une convergence aux promesses vertigineuses
Depuis les premières IRM des années 1970, les progrès conjoints des capteurs neuronaux, du traitement de données et de l’IA ont donné naissance à des dispositifs de plus en plus précis, accessibles et intrusifs. Les bandeaux EEG connectés, capables d’analyser en temps réel l’activité cérébrale via des algorithmes d’apprentissage automatique, en sont une illustration frappante.
Le marché mondial des neurotechnologies, estimé à plus de 21 milliards de dollars d’ici 2026, investit de multiples secteurs : suivi de vigilance dans les transports, optimisation du bien-être mental, interfaces neuronales pour contrôler des machines, amélioration des performances au travail, ciblage marketing…
Ce champ en pleine expansion transforme l’homme en système de données biologiques.
-
Vers une surveillance cognitive : du progrès à la prédation mentale ?
L’IA appliquée à la cognition humaine permet désormais une lecture fine des états mentaux, émotions et niveaux d’attention. Dans l’industrie minière, des entreprises comme Wenco ont recours à des bandeaux neuronaux (LifeBand) pour détecter la fatigue des conducteurs. L’algorithme analyse en temps réel l’état cognitif et prévient les risques d’accident.
Mais ces avancées ouvrent la porte à une forme inédite de surveillance mentale. Certaines entreprises testent déjà des dispositifs pour mesurer la concentration, les émotions ou les réactions de leurs employés. Cette quantification de l’esprit transforme le lieu de travail en espace d’intrusion cognitive, brouillant la frontière entre productivité et contrôle.
-
Neuromarketing : le cerveau, nouvel eldorado des marques
L’une des applications les plus controversées est sans doute le neuromarketing, discipline qui mobilise neurosciences et IA pour décrypter les mécanismes inconscients de décision. Grâce à l’IRM fonctionnelle, à l’EEG ou à l’eye-tracking, les marques sondent nos émotions profondes pour adapter leurs campagnes et influencer nos comportements d’achat.
Ces stratégies, si efficaces soient-elles, posent des risques majeurs :
-
Violation de l’intimité mentale, par l’analyse de réactions inconscientes sans consentement explicite ;
-
Manipulation subliminale, orientant les décisions à l’insu des consommateurs ;
-
Discrimination cognitive, en ciblant ou en écartant des profils selon leur « rentabilité émotionnelle ».
Le neuromarketing joue sur la mémoire associative, concept fondé sur l’idée de Donald Hebb : « les neurones qui s’activent ensemble se connectent ensemble ». Un principe puissant… mais aussi redoutable lorsqu’il est utilisé pour conditionner les choix du consommateur.
-
Neurodroit : défendre le dernier bastion de la liberté humaine

Face à ces enjeux, une nouvelle discipline émerge : le neurodroit. Elle cherche à établir des garde-fous juridiques face aux intrusions dans la sphère mentale.
Parmi les questions soulevées :
-
Les données cérébrales peuvent-elles être utilisées comme preuve judiciaire ?
-
La responsabilité pénale doit-elle être repensée à la lumière des déterminismes neuronaux ?
-
Comment garantir le respect de la liberté de pensée à l’ère des technologies intrusives ?
Des institutions comme l’UNESCO ont initié depuis 2024 des travaux pour établir un cadre éthique et juridique mondial. En ligne de mire : la reconnaissance des neurodroits fondamentaux, comme la protection de l’identité mentale, de la vie privée cognitive ou du libre arbitre.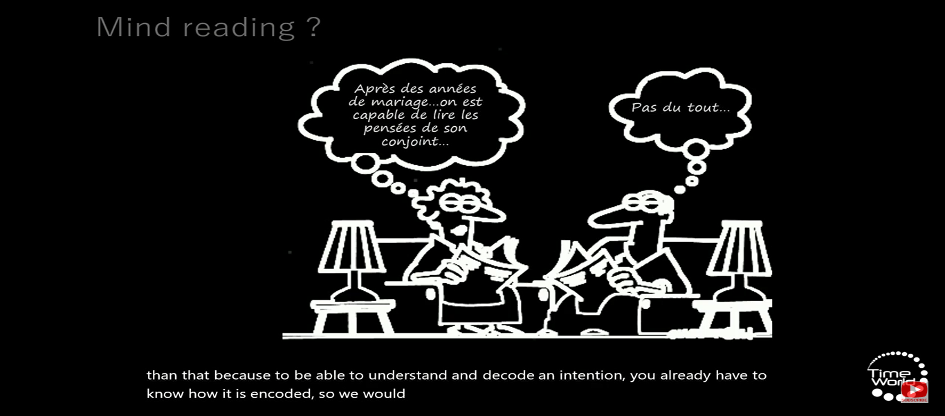
Conclusion : un tournant civilisationnel sous haute vigilance
À l’heure où émergent de nouveaux champs transdisciplinaires tels que la neuro-économie, qui explore les mécanismes cérébraux à l’œuvre dans nos décisions économiques, ou la neuro-philosophie, qui interroge les fondements de la conscience, de la morale et du libre arbitre à la lumière des neurosciences, un tournant civilisationnel s’opère sous nos yeux.
L’alliance entre neurosciences et intelligence artificielle ouvre une ère inédite. Le potentiel est immense : soins neurologiques, apprentissage accéléré, environnements cognitifs optimisés…
Mais cette révolution cognitive s’accompagne de risques inédits : contrôle mental, marchandisation de la pensée, perte de souveraineté individuelle. Sans régulation éthique claire, sans droits robustes à la pensée libre, ces technologies pourraient transformer l’humain en objet d’expérimentation ou d’exploitation.
Malgré tous ces progrès, le cerveau humain demeure l’un des objets les plus complexes et mystérieux. Son fonctionnement échappe encore aux scientifiques sur bien des aspects. Comme le rappelait Niels Bohr, prix Nobel de physique :
« Le but de la science n’est pas de découvrir comment est la nature, mais ce que nous pouvons dire sur la nature. »
(*) : Ahmed Khaouja est expert de l’UIT et membre du Conseil d’Administration de l’ANRT au Maroc
 LTE Magazine LTE MAGAZINE 2025
LTE Magazine LTE MAGAZINE 2025